Une partie de l’équipe
et les deux actrices (laura Tontini et Virginie Molina) face au parc du Château
de Brou
Des scènes de « Torture » tournées dans la région
Le parc du château de Brou a servi jeudi 12 septembre après-midi de décor pour le tournage d’un court-métrage dont l’action se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Torture… c’est le titre du court-métrage d’une durée de 8 minutes, écrit et réalisé par Victor Dartinet, un Chellois de 22 ans.
Victor, à gauche,
surveille une scène. A la caméra, Pierre Wittermer, et au script Mathieu
Dartinet.
Etudiant à l’Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation (Eicar), il a déjà réalisé en mars un spot de prévention sur les acouphènes. « Épris d’Histoire, surtout celle du 20e siècle, j’ai voulu porter le choix du thème de mon premier court-métrage sur cette période qui me passionne particulièrement. Ce film entend montrer les sacrifices auxquels étaient prêts de nombreux résistants afin de conserver des informations ayant, pour la plupart, menées à la libération nationale ». Pour mener à bien son projet, Victor a fait appel à cinq jeunes comédiens et constitué une équipe de huit techniciens, la plupart issus de son école.
Petit
budget mais grande émotion
« Même si c’est court, mon rôle fait ressortir certaines
émotions et c’est toujours un exercice intéressant pour un acteur. Le petit
budget du film n’enlève rien à sa qualité et il y a une très bonne ambiance sur
le plateau »
reconnaît Léo Lesbègue, 20 ans, héros principal du film. Car côté financement,
Victor a lancé une souscription via un site participatif bien connu des
internautes (Ulule). Les fonds recueillis correspondent à un quart du budget
total estimé à 850 euros, sachant que la location des uniformes allemands
représente près de 20 % de ce budget. Victor financera le solde avec ses
deniers personnels. Grâce à l’aimable autorisation des propriétaires, le
tournage a débuté jeudi 12 septembre dans le décor du parc du château de Brou.
Comme
de vrais pros… qu’ils seront
Élève en 1ère année à Eicar, spécialité son, Benoît Griesbach vient de Cergy
(95). « C’est au
moins mon 15e tournage. Je suis aussi musicien-compositeur à l’image.
Auparavant j’ai fait des écoles d’ingénieur et puis j’ai tout arrêté pour me
consacrer à ma passion » confie-t-il
en veillant à ne mettre sa perche-son dans le champ de la caméra Panasonic HMC.
« Silence, on tourne ! Évitez de marcher sur le gravier ! » clame Romain Bonningue. En
tant qu’assistant réalisateur, il ne s’occupe pas des acteurs, dont la
direction est du ressort du réalisateur, mais gère l’équipe technique. « Je
suis en fait le pont entre l’imaginaire et la faisabilité » reconnaît-il en esquissant un
sourire.
«
Ce film est pour moi un challenge »
Tel un ressort, Eloïse Martin bondit entre deux prises pour un raccord
maquillage. Agée de 20 ans, élève à l’Institut technique de maquillage
artistique professionnel de Paris, elle a déjà participé à quatre tournages
étudiants et définit sa prestation comme un challenge. « Le
plus difficile sur un tournage comme celui-ci est de travailler rapidement,
c’est-à-dire qu’on me donne un minimum de temps pour faire des choses parfois
assez compliquées ».
Laura Tontini écoute les dernières instructions de Victor. Future comédienne,
elle a tourné en juin dernier au château de Valmath, (près de Limoges) dans un
court-métrage, L’homme en rouge, qui
sortira le 25 septembre à Paris. La scène de son arrestation a été enregistrée
à la chapelle Sainte-Bathilde, à Chelles. Laurent Cussinet, 29 ans, acteur
professionnel issu de l’école de théâtre corporel Jacques-Lecoq, campe le
général SS qui vient l’arrêter. « J’ai rencontré Victor sur un tournage où
je jouais un rôle d’inspecteur. Victor m’a demandé d’interpréter un personnage
sombre, avec une voix grave et posée qui affirme à la fois son assurance et sa
détermination ».
L’occasion de faire apparaître les deux uniformes allemands loués chez « Le
vestiaire », magasin parisien spécialisé dans les costumes et accessoires, bien
connu des réalisateurs de cinéma et de télévision. La séquence de torture,
quant à elle, a été filmée dans les locaux de l’école Eicar, à La
Plaine-St-Denis (93).Le film sera visible sur le site du réalisateur, mais il
envisage aussi de contacter le cinéma Cosmos pour une projection destinée aux
Chellois.
S. Moroy
Les deux héros du
film, Léo et Jeanne, font une pause avant d'enchaîner la scène romantique au
début du film
Le
pitch du film
Dans la France occupée de
1940, Jeanne Arpane (Laura Tontini) mène une vie ordinaire lorsque soudain son
destin bascule. Son mari Léo (Léo Lesbègue) est capturé par la gestapo lors
d’une opération de sabotage. Jeanne est à son tour arrêtée par les nazis. Confronté
à son mari, elle fait l’objet d’un odieux chantage de la part du général
Weissmuller (Laurent Cussinet) en vue de soutirer à son époux les précieux
renseignements qu’il détient.
Le château de Brou
On ignore la date de sa construction car les archives ont en partie été
détruites par les Prussiens en 1870. Le pigeonnier, privilège seigneurial,
daterait de 1545 mais le château a été édifié vers le milieu du 17e siècle par
Paul-Esprit Feydau, intendant du roi. Il a subi des travaux tout au long du 18e
siècle avant de devenir en 1844 propriété de Charles-Floréal Thiébaut, fondeur
en bronze d’art à Paris. Classé monument historique en 1984, il a été mis en
vente par ses propriétaires fin 2011. Claude Chabrol y a tourné un film pour la
télévision, juste avant sa mort en septembre 2010.
Le général SS
Weissmuller pénètre dans la chapelle Ste-Bathilde pour arrêter Jeanne venue
prier pour son mari.
La chapelle
Ste-Bathilde, à Chelles
L’édifice se trouve au 39 avenue de la Résistance. A l’origine, c’était une
ancienne grange à bois louée par la paroisse pour l’exercice du culte. Elle
reçut en 1916 le nom de chapelle Sainte-Bathilde en souvenir de celle qui vécut
à Chelles au 7e siècle. L’édifice devient la propriété de l’association
diocésaine de Meaux en 1983.
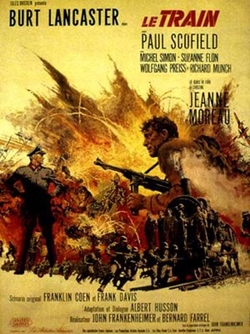



Les commentaires récents