Dur, dur d’être bagnard…
Pichegru, Dreyfus, Lagrange, Seznec, Papillon… Quel est le trait commun entre ces hommes ? Le bagne, bien sûr ! Dans le cadre de l’exposition sur le bagne de la Guyane ou « la guillotine sèche » (ainsi appelé par des députés de la IIIe République hostiles à la peine capitale) qui se tient actuellement à la bibliothèque de la Roseraie, Bernard Borghésio-Ruff a donné vendredi 6 novembre à 20h30 une conférence très intéressante sur les anciens bagnes équatoriaux français. Une leçon d’histoire qui a littéralement captivé l’assistance villevaudéenne.
Pendant 2h30, le conférencier a tenu en haleine un auditoire de 35 personnes, ce qui attestait bien de l’intérêt de son sujet. Il faut dire que l’homme sait de quoi il parle : il a résidé en Guyane française pendant 24 ans, dont 8 ans consacrés à exercer des fonctions de conseilleur pédagogique en pays amérindien et 3 en tant que documentaliste. Passionné d’histoire, il a soigneusement consigné les récits d’anciens bagnards restés sur place et photographié les vestiges des camps encore existants. Parallèlement il a publié un livre sur la Guyane pour inviter les touristes à découvrir ce lointain département exotique situé sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, bordé au nord par l’océan Atlantique, au sud par le Brésil et à l’ouest par le Suriname.
Une ordonnance royale de septembre 1748 fixe les nouvelles peines et conditions de détention (les galères sont alors en passe d’être supprimées depuis l’essor de la marine à voile). Les bagnes, à l’époque, sont situés en métropole et la Guyane, territoire français d’outre-mer, ne reçoit alors que des déportés politiques, surtout après la Révolution française. La France tente bien une mise en valeur de la Guyane, mais ses différentes tentatives échouent en raison de la dureté du climat. Dans les années 1780, un timide développement économique s’amorce grâce à un contingent d’esclaves que la France fait venir d’Afrique, mais c’est à partir de 1795 que la Guyane devient un lieu fréquent de déportation pour les opposants politiques aux régimes qui se succèdent en France. L’esclavage est aboli en avril 1848 et Napoléon III décide par une loi promulguée le 30 mai 1854 d’établir une colonie pénitentiaire hors de France avec les bagnes de Saint-Laurent-du-Maroni, de l’île du Diable et de Cayenne. Cette même loi prend également soin de définir « le doublage »: c’’est-à-dire que le déporté sera astreint à résidence en Guyane à la fin de sa peine pour une durée égale à celle-ci si elle est comprise entre 5 et 8 ans ; à perpétuité si elle atteint ou dépasse 8 ans. Mais Cayenne, capitale de ce territoire, contrairement à ce que l’on a souvent cru, ne fut qu’un centre pénitentiaire mineur (environ 200 condamnés et les libérés devaient obtenir une autorisation spéciale pour y résider).
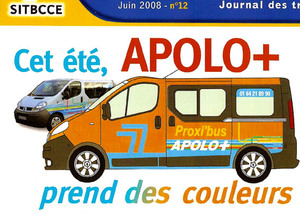
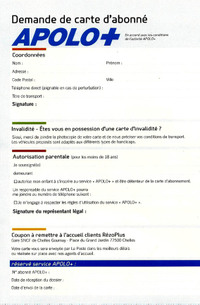
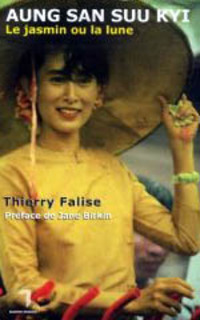

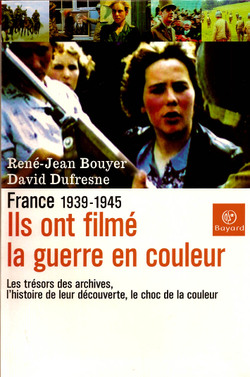
Les commentaires récents